Mot Mana
Dans le lexique d'un auteur, ne faut-il pas qu'il y ait toujours un mot-mana, un mot dont la signification ardente, multiforme, insaisissable et comme sacrée, donne l'illusion que par ce mot on peut répondre à tout ?
Roland Barthes.


Qu'est-ce que le Mana ?
Selon le dictionnaire de l’Académie tahitienne en première entrée, le mana signifie « puissant, fort, qui a de l’autorité. » Cette vision envoie à la définition la plus souvent retrouvée dans les dictionnaires transmis par les missionnaires. John Davies le traduit en 1851 par « pouvoir » dans son dictionnaire Tahitian and English Dictionary7 ou encore, Etienne Tepano Jaussen le définit par puissance ou « être influent » en 1861.8 Cette notion est également rapportée par Ernst Dieffenbach, dont l’ouvrage Voyages en Nouvelle Zélande est à l’origine de la première définition du mana publiée dans le très réputé dictionnaire Oxford English Dictionary.
Cité comme source pour l’étymologie du mot, le médecin et explorateur allemand circonscrit le mana comme « pouvoir, autorité. » Cette force autoritaire a un statut sacré, un tapu devenu tabou, interdit car réservé à quelques élus. Ce mana qui punit impose l’idée d’une loi divine autoritaire s’exerçant sur les hommes.
Dans Tahiti aux temps anciens de Teuira Henry surgit une autre conception du mana. Le mot est associé à un lieu historique situé à Raiatea, l’île sacrée. L’article relate des événements surnaturels autour de pierres chargées de mystère. Ce caractère magique se retrouve chez Marcel Mauss au fil de ses travaux sur le don et sur la magie.
« En somme, ce mot (mana) subsume une foule d'idées que nous désignerions par les mots de : pouvoir de sorcier, qualité magique d'une chose, chose magique, être magique, avoir du pouvoir magique, être incanté, agir magiquement ; il nous présente, réunies sous un vocable unique, une série de notions dont nous avons entrevu la parenté, mais qui nous étaient, ailleurs, données à part. Il réalise cette confusion de l'agent, du rite et des choses qui nous a paru être fondamentale en magie. »
Marcel Mauss s’appuie sur les propos de Robert H. Codrington considéré comme le « père du mana. » Premier ayant rapporté sur ce qu’il a associé à une pratique religieuse, l’anthropologue et pasteur anglais qualifie le mana de « croyance autochtone dans la magie. » Il la retrouve dans les nombreuses pratiques des Mélanésiens : pêche, pierre, chant, l’eau bue ou traversée, etc.
« C’est le mana. (…) C’est un pouvoir ou une influence loin d’être physique, elle est plutôt surnaturelle mais elle se manifeste dans le corps ou en toute forme de pouvoir qu’un homme peut détenir. Le mana est fluide, il est présent en toute chose ou presque ; les esprits qu’ils soient des âmes désincarnées ou des êtres surnaturels le possèdent et peuvent le transmettre ; il est à la source des êtres même s’il peut se manifester à travers l’eau, les pierres ou les os. L’ensemble de la religion mélanésienne consiste à s’approprier ce mana ou à l’utiliser à son profit - la religion est ici à comprendre comme un ensemble de pratiques, de prières et de sacrifices. »
Posé dans ce caractère magique dense, complexe et incarné par un seul mot, le mana génère une querelle scientifique au sein de la société anthropologique et sociologique européenne. Roger Keesing oppose à Robert H. Codrington son interprétation du mana au nom de la préservation de la culture māori, ouvrant une deuxième trajectoire de la diffusion du concept au sein de la communauté scientifique.15 Cette fluidité conceptuelle est notamment synthétisée par plusieurs auteurs dans un effort de rationalisation de ce mana insaisissable.
En 1940, Raymond Firth résume ainsi les définitions apportées par les différents penseurs de ce mot historique :
« Le mana a été transmis par : un pouvoir surnaturel, une influence (Codrington) ; un pouvoir magique ; une force psychique (Marett) ; une force religieuse interpersonnelle ; un principe totémique (Durkheim) ; une force divine (Handy) ; un effet ; un miracle ; une autorité ; un prestige ; etc. (Tregear) ; une vérité (Hocart). »
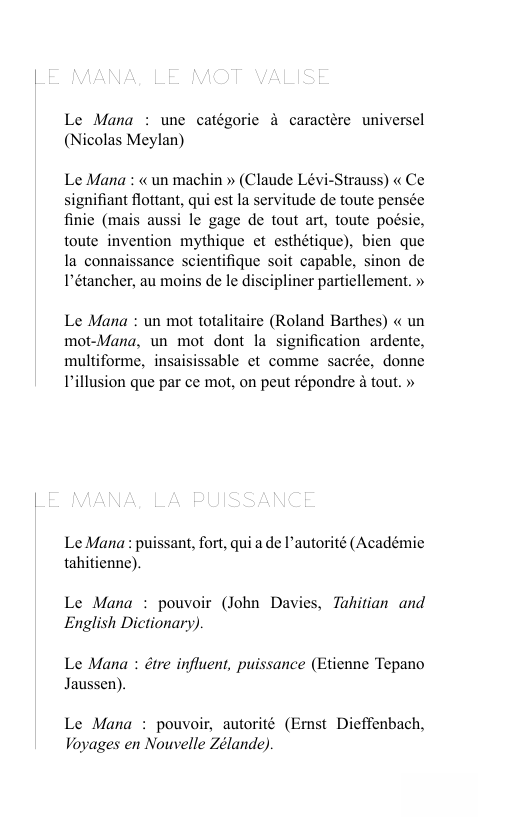
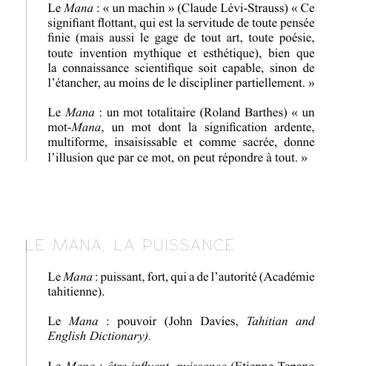
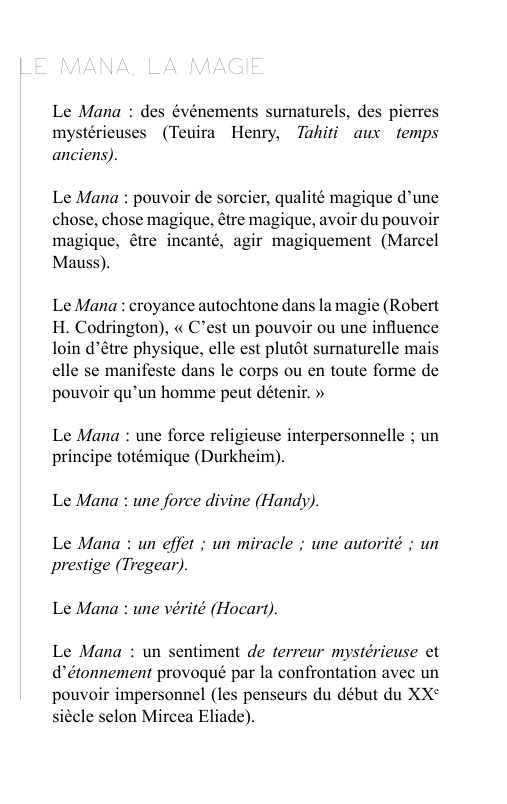
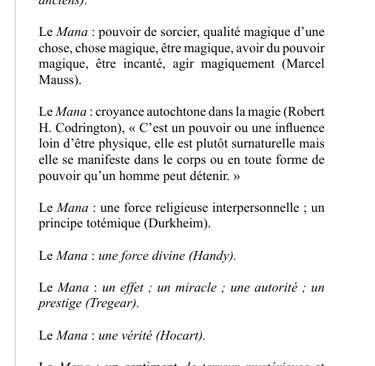
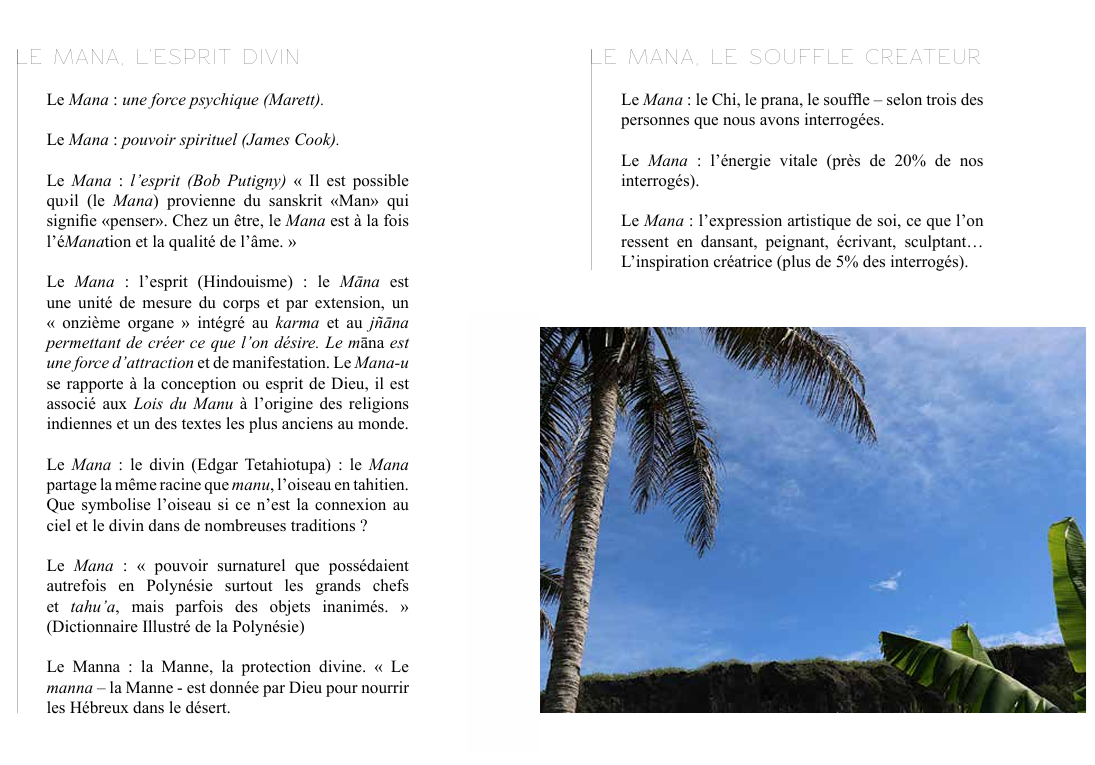
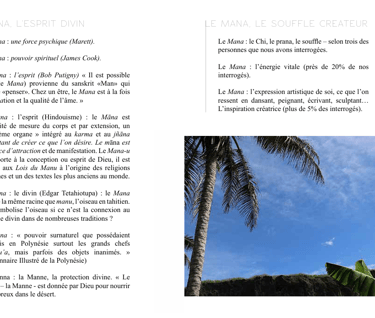
Mana Médium
En alliant mon parcours d'enseignante-chercheure, écrivain et perceptive, le mot mana-médium est apparu. Ce terme détient toutes les facultés de transmission du message que Regis Debray décrit. Le mana-médium est un « procédé général de symbolisation (…) ; un code social de communication (…) ; un support matériel d’inscription et de stockage (…) ; et un dispositif d’enregistrement et de diffusion. » Ce mot, je l'institue et le définit dans mon article Le mana, marque d’une transmission symbolique et développé au cours de ma conférence à Angers autour de l'épistémologie de la communication environnementale.
Le médium est devenu un corps, les médias sont aujourd'hui une intelligence médiatique. Le mana est associé à un être en charge de sa transmission symbolisée par le tupuna, celui qui porte les mémoires de la société. En tant que tel, le mana-médium appelle à un renouveau d’un mana transmission à la fois corps, les personnes pouvant réécrire le sacré structurant de la conception universelle du monde - et du Village Global selon Marshall McLuhan ; et à la fois contenu, une transmission à distance des mots vidés de leur sens à la faveur d’une transmission hybride et renouvelée de l’identité universelle.
Le mot Mana-Médium apporte une vision pour une communication éclairée, consciente et responsable.
A suivre.


